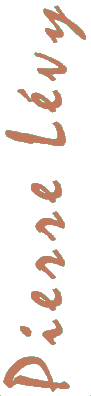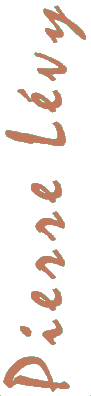|
EDUCATION
ET CYBERCULTURE
Extrait
de l’ouvrage « cyberculture » à paraître le 21
novembre aux éditions Odile Jacob
Pierre
Lévy
Le nouveau rapport au savoir
Education et cyberculture
Toute réflexion sérieuse sur le devenir
des systèmes d’éducation et de formation dans la cyberculture
doit se fonder sur une analyse préalable de la mutation contemporaine
du rapport au savoir. A cet égard, le premier constat concerne la
vitesse d’apparition et de renouvellement des savoirs et savoir-faire.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la plupart
des compétences acquises par une personne au début de son
parcours professionnel seront obsolètes à la fin de sa carrière.
Le second constat, fortement lié au premier, concerne la nouvelle
nature du travail, dont la part de transaction de connaissances ne cesse
de croître. Travailler revient de plus en plus à apprendre,
transmettre des savoirs et produire des connaissances. Troisième
constat : le cyberespace supporte des technologies intellectuelles qui
amplifient, extériorisent et modifient nombre de fonctions cognitives
humaines : mémoire (bases de données, hyperdocuments, fichiers
numériques de tous ordres), imagination (simulations), perception
(capteurs numériques, téléprésence, réalités
virtuelles), raisonnements (intelligence artificielle, modélisation
de phénomènes complexes). Ces technologies intellectuelles
favorisent...
- de nouvelles formes d’accès à l’information
: navigation hyperdocumentaire, chasse au renseignement par moteurs de
recherche, knowbots ou agents logiciels, exploration contextuelle
par cartes dynamiques de données,
- de nouveaux styles de raisonnement et de connaissance,
telle que la simulation, véritable industrialisation de l’expérience
de pensée, qui ne relève ni de la déduction logique,
ni de l’induction à partir d’expérience.
Du fait que ces technologies intellectuelles, et
notamment les mémoires dynamiques, sont objectivées
dans des documents numériques ou des logiciels disponibles sur réseau
(ou facilement reproductibles et transférables), elles peuvent être
partagées entre un grand nombre d’individus et accroissent
donc le potentiel d’intelligence collective des groupes humains.
le savoir-flux, le travail-transaction de connaissance,
les nouvelles technologies de l’intelligence individuelle et collective
changent profondément les données du problème de l’éducation
et de la formation. Ce qu’il faut apprendre ne peut plus être planifié
ni précisément défini à l’avance. Les parcours
et profils de compétences sont tous singuliers et peuvent de moins
en moins se canaliser dans des programmes ou cursus valables pour tout
le monde. Nous devons nous construire de nouveaux modèles de l’espace
des connaissances. A une représentation en échelles linéaires
et parallèles, en pyramides structurées par « niveaux
», organisées par la notion de prérequis et convergeant
vers des savoirs « supérieurs », il nous faut dorénavant
préférer l’image d’espaces de connaissances émergents,
ouverts, continus, en flux, non linéaires, se réorganisant
selon les objectifs ou les contextes et sur lequel chacun occupe une position
singulière et évolutive.
Dès lors, deux grandes réformes sont
requises des systèmes d’éducation et de formation. Premièrement
l’acclimatation des dispositifs et de l’esprit de l’AOD (apprentissage
ouvert et à distance) dans le quotidien et l’ordinaire de l’éducation.
L’AOD exploite certes certaines techniques de l’enseignement à distance,
y compris les hypermédias, les réseaux de communication interactifs
et toutes les technologies intellectuelles de la cyberculture. Mais l’essentiel
réside dans un nouveau style de pédagogie, qui favorise à
la fois les apprentissages personnalisés et l’apprentissage coopératif
en réseau. Dans ce cadre, l’enseignant est appelé à
devenir un animateur de l’intelligence collective de ses groupes d’élèves
plutôt qu’un dispensateur direct de connaissances.
La deuxième réforme concerne la reconnaissance
des acquis. Si les gens apprennent dans leurs expériences sociales
et professionnelles, si l’école et l’université perdent progressivement
leur monopole de la création et de la transmission de la connaissance,
les systèmes d’éducation publics peuvent du moins se donner
la nouvelle mission d’orienter les parcours individuels dans le savoir
et de contribuer à la reconnaissance de l’ensemble des savoir-faire
détenus par les personnes, y compris les savoirs non-académiques.
Les outils du cyberespace permettent d’envisager de vastes systèmes
de tests automatisés accessibles à tout moment et des réseaux
de transaction entre offre et demande de compétence. Organisant
la communication entre employeurs, individus et ressources d’apprentissage
de tous ordres, les universités de l’avenir contribueraient ainsi
à l’animation d’une nouvelle économie de la connaissance.
Ce chapitre et le suivant développent les
idées qui viennent d’être exposées et proposent pour
finir certaines solutions pratiques (les « arbres de connaissances
»).
L’articulation
d’une multitude de points de vue sans point de vue de Dieu
Dans un de mes cours à l'Université
de Paris-8, intitulé "technologies numériques et mutations
culturelles", je demande à chaque étudiant de faire à
la classe un exposé de dix minutes. La veille de l'exposé,
ils doivent me rendre une synthèse de deux pages, avec une bibliographie,
qui pourra éventuellement être photocopiée par les
autres étudiants désireux d'approfondir le sujet.
En 1995, l'un d'eux me tend ses deux pages de résumé
en me disant d'un air un peu mystérieux : "Tenez! Il s'agit d'un
exposé virtuel!" J'ai beau feuilleter son travail sur les instruments
de musique numériques, je ne vois pas ce qui le distingue des synthèses
habituelles : un titre en gras, des sous-titres, des mots soulignés
dans un texte plutôt bien articulé, une bibliographie. S'amusant
de mon scepticisme, il m'entraîne vers la salle des ordinateurs et,
suivis par quelques autres étudiants, nous nous installons autour
d'un écran. Je découvre alors que les deux pages de résumé
que j'avais parcouru sur du papier étaient la projection imprimée
de pages Web.
Au lieu d’un texte localisé, figé
sur un support de cellulose, à la place d'un petit territoire avec
un auteur propriétaire, un début, une fin, des marges formant
frontières, j'étais confronté à un document
dynamique, ouvert, ubiquitaire, me renvoyant à un corpus pratiquement
infini. Le même texte avait changé de nature. On parle de
« page » dans les deux cas, mais la première page est
un pagus, un champ borné, approprié, semé de
signes enracinés, l'autre est une unité de flux, soumise
aux contraintes du débit dans les réseaux. Même si
elle se réfère à des articles ou à des livres,
la première page est physiquement close. La seconde, en revanche,
nous connecte techniquement et immédiatement à des pages
d'autres documents, dispersées partout sur la planète, qui
renvoient elles-mêmes indéfiniment à d'autres pages,
à d'autres gouttes du même océan mondial de signes
fluctuants.
A partir de l'invention d'une petite équipe
du CERN, le World Wide Web s'est propagé parmi les utilisateurs
de l’Internet comme une traînée de poudre pour devenir en
quelques années un des principaux axes de développement du
cyberespace. Cela n'exprime peut-être qu'une tendance provisoire.
Je fais cependant l'hypothèse que l'irrépressible croissance
du Web nous indique quelques traits essentiels d'une culture qui veut naître.
Gardant cela en tête, poursuivons notre analyse.
La page Web est un élément, une partie
du corpus insaisissable de l'ensemble des documents du World Wide Web.
Mais par les liens qu'elle lance vers le reste du réseau, par les
carrefours ou les bifurcations qu'elle propose, elle constitue aussi une
sélection organisatrice, un agent structurant, un filtrage de ce
corpus. Chaque élément de cette pelote incirconscriptible
est à la fois un paquet d'information et un instrument de navigation,
une partie du stock et un point de vue original sur le dit stock. Sur une
face, la page Web forme la gouttelette d'un tout fuyant, sur l'autre face,
elle propose un filtre singulier de l’océan d’information.
Sur le Web, tout est sur le même plan. Et
cependant tout est différencié. Il n'y a pas de hiérarchie
absolue, mais chaque site est un agent de sélection, d’aiguillage
ou de hiérarchisation partielle. Loin d'être une masse amorphe,
le Web articule une multitude ouverte de points de vue, mais cette articulation
s'opère transversalement, en rhizome, sans point de vue de Dieu,
sans unification surplombante. Que cet état de fait engendre de
la confusion, chacun en convient. De nouveaux instruments d'indexation
et de recherche doivent être inventés, comme en témoigne
la richesse des travaux actuels sur la cartographie dynamique des espaces
de données, les "agents" intelligents ou le filtrage coopératif
des informations. Il est néanmoins fort probable que, quels que
soient les progrès à venir des techniques de navigation,
le cyberespace gardera toujours son caractère foisonnant, ouvert,
radicalement hétérogène et non totalisable.
Le
deuxième déluge et l’inaccessibilité du tout
Sans clôture sémantique ou structurelle,
le Web n'est pas non plus figé dans le temps. Il enfle, bouge et
se transforme en permanence. Le World Wide Web est en flux, en flot. Ses
sources innombrables, ses turbulences, son irrésistible montée
offrent une saisissante image de la crue d’information contemporaine. Chaque
réserve de mémoire, chaque groupe, chaque individu, chaque
objet peut devenir émetteur et faire gonfler le flot. A ce sujet,
Roy Ascott parle, d'une manière imagée, du deuxième
Déluge. Le Déluge d'informations. Pour le meilleur ou
pour le pire, ce Déluge-là ne sera suivi d'aucune décrue.
Nous devons nous habituer à cette profusion et à ce désordre.
Sauf catastrophe culturelle, aucune grande remise en ordre, aucune autorité
centrale ne nous ramènera à la terre ferme ni aux paysages
stables et bien balisés d'avant l'inondation.
Le point de basculement historique du rapport au
savoir se situe sans doute à la fin du XVIIIe siècle, en
ce moment d'équilibre fragile où l'ancien monde jetait ses
plus beaux feux tandis que les fumées de la révolution industrielle
commençaient à changer la couleur du ciel. Quand Diderot
et d'Alembert publiaient leur grande Encyclopédie. Jusqu'à
ce temps, un petit groupe d'homme pouvait espérer maîtriser
l'ensemble des savoirs (ou tout au moins les principaux) et proposer aux
autres l'idéal de cette maîtrise. La connaissance était
encore totalisable, sommable. A partir du dix-neuvième siècle,
avec l'élargissement du monde, la découverte progressive
de sa diversité, la croissance toujours plus rapide des connaissances
scientifiques et techniques, le projet de maîtrise du savoir par
un individu ou un petit groupe devint de plus en plus illusoire. Aujourd'hui,
il est devenu évident, tangible pour tous, que la connaissance est
définitivement passée du côté de l'intotalisable,
de l'immaîtrisable. Il nous faut lâcher prise.
L'émergence du cyberespace ne signifie nullement
que "tout" est enfin accessible, mais bien plutôt que le Tout est
définitivement hors d’atteinte. Que sauver du Déluge ? Qu'allons-nous
mettre dans l'Arche ? Penser que nous pourrions construire une Arche contenant
"le principal" serait justement céder à l'illusion de la
totalité. Nous avons tous besoin, institutions, communautés,
groupes humains, individus, de construire du sens, de nous aménager
des zones de familiarité, d'apprivoiser le chaos ambiant. Mais,
d'une part, chacun doit reconstruire des totalités partielles à
sa manière, suivant ses propres critères de pertinence. D'autre
part, ces zones de signification appropriées devront forcément
être mobiles, changeantes, en devenir. Si bien qu'à l'image
de la grande Arche nous devons substituer celle d’une flottille de petites
arches, barques ou sampans, une myriade de petites totalités, différentes,
ouvertes et provisoires, sécrétées par filtrage actif,
perpétuellement remises sur le métier par les collectifs
intelligents qui se croisent, se hèlent, se heurtent ou se mêlent
sur les grandes eaux du Déluge informationnel.
Les métaphores centrales du rapport au savoir
sont donc aujourd'hui la navigation et le surf, qui impliquent une capacité
d'affronter les vagues, les remous, les courants et les vents contraires
sur une étendue plane, sans frontières et toujours changeante.
En revanche, les vieilles métaphores de la pyramide (gravir la pyramide
du savoir) de l'échelle ou du cursus (déjà
tout tracé) fleurent bon les hiérarchies immobiles d'antan.
Qui
sait? La réincarnation du savoir
Les pages Web expriment les idées, les désirs,
les savoirs, les offres de transaction de personnes et de groupes humains.
Derrière le grand hypertexte grouille la multitude et ses rapports.
Dans le cyberespace, le savoir ne peut plus être conçu comme
quelque chose d’abstrait ou de transcendant. Il devient de plus en plus
visible - et même tangible en temps réel - qu'il exprime
une population. Les pages Web sont non seulement signées, comme
les pages de papier, mais elles débouchent souvent sur une communication
directe, interactive, par courrier numérique, forum électronique,
ou autres formes de communication par mondes virtuels comme les MUDs ou
les MOOs. Ainsi, contrairement à ce que laisse croire la vulgate
médiatique sur la prétendue "froideur" du cyberespace, les
réseaux numériques interactifs sont des facteurs puissants
de personnalisation ou d'incarnation de la connaissance.
Inlassablement, il faut rappeler l’inanité
du schème de la substitution. De même que la communication
par téléphone n'a pas empêché les gens de se
rencontrer physiquement, puisqu'on se téléphone pour prendre
rendez-vous, la communication par messages électroniques prépare
bien souvent des voyages physiques, des colloques ou des réunions
d'affaires. Même lorsqu'elle n'accompagne pas de rencontre matérielle,
l'interaction dans le cyberespace reste une forme de communication. Mais,
entend-on parfois argumenter, certaines personnes restent des heures "devant
leur écran", s'isolant ainsi des autres. Les excès ne doivent
certes pas être encouragés. Mais dit-on de quelqu'un qui lit
qu'il "reste des heures devant du papier". Non. Parce que la personne qui
lit n'est pas en rapport avec une feuille de cellulose, elle est en contact
avec un discours, des voix, un univers de signification qu'elle contribue
à construire, à habiter par sa lecture. Que le texte s'affiche
sur un écran ne change rien au fond de cette affaire. Il s'agit
toujours de lecture, même si, comme nous l’avons vu, avec les hyperdocuments
et l’interconnexion générale, les modalités de la
lecture tendent à se transformer.
Quoique les supports d’information ne déterminent
pas automatiquement tel ou tel contenu de connaissance, ils contribuent
cependant à structurer fortement « l’écologie cognitive
» des sociétés. Nous pensons avec et dans des groupes
et des institutions qui tendent à reproduire leur idiosyncrasie
en nous imprégnant de leur climat émotionnel et de leurs
fonctionnements cognitifs. Nos facultés de connaître travaillent
avec des langues, des systèmes de signes et des procédés
intellectuels fournis par une culture. On ne multiplie pas de la même
manière avec des cordes à nœuds, des cailloux, des chiffres
romains, des chiffres arabes, des bouliers, des règles à
calculs ou des calculettes. Les vitraux des cathédrales et les écrans
de télévision, ne nous offrant pas les mêmes images
du monde, ne suscitent pas les mêmes imaginaires. Certaines représentations
ne peuvent survivre longtemps dans une société sans écriture
(chiffres, tableaux, listes) tandis que l’on peut les archiver aisément
dès qu’on dispose de mémoires artificielles. Pour coder leurs
savoirs, les sociétés sans écriture ont développé
des techniques de mémoire reposant sur le rythme, le récit,
l’identification, la participation du corps et l’émotion collective.
En revanche, avec la montée de l’écriture, le savoir a pu
se détacher partiellement des identités personnelles ou collectives,
devenir plus « critique », viser une certaine objectivité
et une portée théorique « universelle ». Ce ne
sont pas seulement les modes de connaissances qui dépendent des
supports d’information et des techniques de communication. Ce sont aussi,
par l’intermédiaire des écologies cognitives qu’elles conditionnent,
les valeurs et les critères de jugements des sociétés.
Or ce sont précisément les critères d’évaluation
du savoir (au sens le plus large de ce terme) qui sont mis en jeu par l’extension
de la cyberculture, avec le déclin probable, déjà
observable, des valeurs qui avaient cours dans la civilisation structurée
par l’écriture statique. Non que ces valeurs soient appelées
à disparaître mais plutôt à devenir secondaire,
à perdre leur pouvoir de commandement.
Peut-être plus important encore que les genres
de connaissances et les critères de valeur qui les polarisent, chaque
écologie cognitive favorise certains acteurs, placés au centre
des processus d’accumulation et d’exploitation du savoir. Ici, la question
n’est plus « comment ? », ni « selon quels critères
? » mais « qui ? ».
Dans les sociétés d'avant l'écriture,
le savoir pratique, mythique et rituel est incarné par la communauté
vivante. Quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque
qui brûle.
Avec la venue de l'écriture, le savoir est
porté par le Livre. Le livre, unique, indéfiniment
interprétable, transcendant, censé tout contenir : la Bible,
le Coran, les textes sacrés, les classiques, Confucius, Aristote…
C'est ici l'interprète qui maîtrise la connaissance.
Depuis l'imprimerie jusqu'à ce matin, un
troisième type de connaissance est hanté par la figure du
savant, du scientifique. Ici, le savoir n'est plus porté
par le livre mais par la bibliothèque. L’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert est moins un livre qu’une bibliothèque. Le
savoir est structuré par un réseau de renvois, hanté
peut-être depuis toujours par l'hypertexte. Alors, le concept, l’abstraction
ou le système servent à condenser la mémoire et à
garantir une maîtrise intellectuelle que l’inflation des connaissances
met déjà en danger.
La déterritorialisation de la bibliothèque
à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est peut-être que
le prélude à l'apparition d'un quatrième type de relation
à la connaissance. Par une sorte de retour en spirale à l'oralité
des origines, le savoir pourrait être de nouveau porté par
les collectivités humaines vivantes plutôt que par
des supports séparés servis par des interprètes ou
des savants. Seulement, cette fois-ci, contrairement à l'oralité
archaïque, le porteur direct du savoir ne serait plus la communauté
physique et sa mémoire charnelle, mais le cyberespace, la
région des mondes virtuels par l'intermédiaire duquel les
communautés découvrent et construisent leurs objets et se
connaissent elles-mêmes comme collectifs intelligents.
Désormais, les systèmes et les concepts
abstraits cèdent du terrain aux cartes fines des singularités,
à la description détaillée des grands objets cosmiques,
des phénomènes de la vie ou des manières humaines.
Que l'on prenne tous les grands projets technoscientifiques contemporains
: physique des particules, astrophysique, génome humain, espace,
nanotechnologies, surveillance des écologies et des climats... ils
sont tous suspendus au cyberspace et à ses outils. Les bases de
données d’images, les simulations interactives et les conférences
électroniques assurent une meilleure connaissance du monde que l’abstraction
théorique, passée au second plan. Ou plutôt, ils définissent
la nouvelle norme de la connaissance. De plus, ces outils permettent une
coordination efficace des producteurs de savoir quand théories
et systèmes suscitaient plutôt l’adhésion ou
le conflit.
Il est frappant de constater que certaines expériences
réalisées dans les grands accélérateurs de
particules mobilisent tant de ressources, sont si complexes et difficiles
à interpréter qu’elles n’ont quasiment lieu qu’une seule
fois. Chaque expérience est presque singulière. Cela semble
contredire l’idéal de reproductibilité de la science classique.
Pourtant, ces expériences sont encore universelles, mais d’une autre
manière que par la possibilité de reproduction. Y participent
une multitude de scientifiques de tous pays qui forment une sorte de microcosme
ou de projection de la communauté internationale. Mais surtout,
le contact direct avec l’expérience a quasiment disparu au profit
de la production massive de données numériques. Or ces données
peuvent être consultées et traitées dans un grand nombre
de laboratoires dispersés grâce aux instrument de communication
et de traitement du cyberespace. Ainsi l’ensemble de la communauté
scientifique peut participer à ces expériences très
particulières, qui sont autant d’événements.
L’universalité repose alors sur l’interconnexion en temps réel
de la communauté scientifique, sa participation coopérative
mondiale aux événements qui la concernent plutôt que
sur la dépréciation de l’événement singulier
qui caractérisait l’ancienne universalité des sciences exactes.
La
simulation, un mode de connaissance propre à la cyberculture
Parmi les nouveaux genres de connaissance portés
par la cyberculture, la simulation occupe une place centrale. D’un mot,
il s’agit d’une technologie intellectuelle qui démultiplie l’imagination
individuelle (augmentation de l’intelligence) et permet à des groupes
de partager, négocier et raffiner des modèles mentaux communs,
quels que soient la complexité de ces modèles (augmentation
de l’intelligence collective). Pour augmenter et transformer certaines
capacités cognitives humaines (la mémoire, l’imagination,
le calcul, le raisonnement expert) l’informatique extériorise
partiellement ces facultés sur des supports numériques.
Or, dès que de tels processus cognitifs sont extériorisés
et réifiés, ils deviennent partageables et renforcent
donc les processus d’intelligence collective... si du moins les techniques
sont utilisées à bon escient.
Même les systèmes experts (ou systèmes
à base de connaissances), traditionnellement rangés sous
la rubrique « intelligence artificielle » devraient être
considérés comme des techniques de communication et de mobilisation
rapide des savoir-faire pratiques dans les organisations plutôt que
comme des doubles d’experts humains. Aussi bien sur le plan cognitif que
sur celui de l’organisation du travail, les technologies intellectuelles
doivent être pensées en termes d’articulation et de mise en
synergie plutôt que selon le schème de la substitution.
Les techniques de simulation, en particulier
celles qui mettent en jeu des images interactives, ne remplacent
pas les raisonnements humains mais prolongent et transforment les capacités
d’imagination et de pensée. En effet, notre mémoire à
long terme peut emmagasiner une très grande quantité d’informations
et de connaissances. En revanche, notre mémoire à court terme,
celle qui contient les représentations mentales auxquelles nous
prêtons une attention délibérée, consciente,
a des capacités fort limitées. Il nous est impossible, par
exemple, de nous représenter clairement et distinctement plus d’une
dizaine d’objets en interactions.
Si nous pouvons évoquer mentalement l’image
du château de Versailles, nous ne parvenons pas à compter
ses fenêtres « dans notre tête ». Le degré
de résolution de l’image mentale n’est pas suffisant. Pour aller
à ce niveau de détail, nous avons besoin d’une mémoire
auxiliaire extérieure (gravure, peinture, photo) grâce à
laquelle nous allons nous livrer à de nouvelles opérations
cognitives : compter, mesurer, comparer, etc. La simulation est une aide
pour la mémoire à court terme qui concerne, non pas des images
fixes, des textes ou des tableaux de chiffres, mais des dynamiques complexes.
La capacité de faire varier facilement les paramètres d’un
modèle et d’observer immédiatement et visuellement les conséquences
de cette variation constitue une véritable amplification de l’imagination.
La simulation joue aujourd’hui un rôle croissant
dans les activités de recherche scientifique, de conception industrielle,
de gestion, d’apprentissage mais également pour le jeu et le divertissement
(notamment dans les jeux interactifs sur écran). Ni théorie
ni expérience, manière d’industrialisation de l’expérience
de pensée, la simulation est un mode spécial de connaissance,
propre à la cyberculture naissante. Dans la recherche, son principal
intérêt n’est évidemment pas de remplacer l’expérience
ni de tenir lieu de réalité mais de permettre la formulation
et l’exploration rapide d’un grand nombre d’hypothèses. Du point
de l’intelligence collective, elle permet la mise en image et le partage
de mondes virtuels et d’univers de signification d’une grande complexité.
Les savoirs sont désormais codés
dans des bases de données accessibles en ligne, dans des cartes
alimentées en temps réel par les phénomènes
du monde et dans des simulations interactives. L’efficience, la fécondité
heuristique, la puissance de mutation et de bifurcation, la pertinence
temporelle et contextuelle des modèles supplantent les anciens critères
d’objectivité et d’universalité abstraite. Mais on retrouve
une forme plus concrète d’universalité par les capacités
de connexion, le respect de standards ou de formats, la compatibilité
ou l’interopérabilité planétaire.
De
l’interconnexion chaotique à l’intelligence collective
Le savoir, détotalisé, fluctue. Il
en résulte un violent sentiment de désorientation. Faut-il
se crisper sur les procédés et les schémas qui assuraient
l’ordre ancien du savoir? Ne faut-il pas au contraire sauter le pas et
pénétrer de plain-pied dans la nouvelle culture, qui offre
des remèdes spécifiques aux maux qu’elle engendre. L’interconnexion
en temps réel de tous avec tous est certes la cause du désordre.
Mais c’est aussi la condition de possibilité des solutions pratiques
aux problèmes d’orientation et d’apprentissage dans l’univers du
savoir en flux. En effet, cette interconnexion favorise les processus d’intelligence
collective dans les communautés virtuelles grâce à
quoi l’individu se trouve moins démuni face au chaos informationnel.
Précisément, l’idéal mobilisateur
de l’informatique n’est plus l’intelligence artificielle (rendre une machine
aussi intelligente, voire plus intelligente qu’un homme) mais l’intelligence
collective, à savoir la valorisation, l’utilisation optimale
et la mise en synergie des compétences, des imaginations et des
énergies intellectuelles, quelles que soient leur diversité
qualitative et où qu’elles se situent. Cet idéal de l’intelligence
collective passe évidemment par la mise en commun de la mémoire,
de l’imagination et de l’expérience, par une pratique banalisée
de l’échange des connaissances, par de nouvelles formes d’organisation
et de coordination souples et en temps réel. Si les nouvelles techniques
de communication favorisent le fonctionnement des groupes humains en intelligence
collective, répétons qu’elles ne le déterminent pas
automatiquement. La défense de pouvoirs exclusifs, des rigidités
institutionnelles, l’inertie des mentalités et des cultures peuvent
évidemment pousser à des utilisations sociales des nouvelles
technologies beaucoup moins positives selon des critères humanistes.
Le cyberespace, interconnexion des ordinateurs
de la planète, tend à devenir l’infrastructure majeure de
la production, de la gestion et de la transaction économique. Il
constituera bientôt le principal équipement collectif international
de la mémoire, de la pensée et de la communication. En somme,
dans quelques dizaines d’années, le cyberespace, ses communautés
virtuelles, ses réserves d’images, ses simulations interactives,
son irrépressible foisonnement de textes et de signes sera le médiateur
essentiel de l'intelligence collective de l’humanité. Avec ce nouveau
support d’information et de communication, émergent des genres de
connaissances inouïs, des critères d’évaluation inédits
pour orienter le savoir, de nouveaux acteurs dans la production et le traitement
des connaissances. Toute politique d’éducation devra en tenir compte.
Les
mutations de l’éducation et l’économie du savoir
L’apprentissage
ouvert et à distance
Les systèmes éducatifs sont aujourd’hui
soumis à de nouvelles contraintes de quantité, de diversité
et de vitesse d’évolution des savoirs. Sur un plan purement quantitatif,
la demande de formation n'a jamais été aussi massive. C'est
désormais, dans de nombreux pays, la majorité d'une
classe d'âge qui suit un enseignement secondaire. Les Universités
débordent. Les dispositifs de formation professionnelle et continue
sont saturés. Pour faire image, on dira que la moitié de
la société est, ou voudrait être, à l'école.
On ne pourra pas augmenter le nombre d'enseignants
proportionnellement à la demande de formation qui
est, dans tous les pays du monde, de plus en plus diverse et massive. La
question du coût de l’enseignement se pose notamment dans les pays
pauvres. Il faudra donc bien se résoudre à trouver des solutions
faisant appel à des techniques capables de démultiplier l'effort
pédagogique des professeurs et des formateurs. Audiovisuel, «
multimédia » interactif, enseignement assisté par ordinateur,
télévision éducative, câble, techniques classiques
de l'enseignement à distance reposant essentiellement sur l'écrit,
tutorat par téléphone, fax ou Internet… Toutes ces possibilités
techniques, plus ou moins pertinentes selon le contenu, la situation et
les besoins de « l'apprenant » peuvent être envisagée
et ont déjà été amplement testées et
expérimentées. Tant sur le plan des infrastructures matérielles
que des coûts de fonctionnement, les écoles et universités
« virtuelles » coûtent moins cher que les écoles
et les universités en béton délivrant un enseignement
en «présentiel».
La demande de formation ne connaît pas seulement
une énorme croissance quantitative, elle subit aussi une profonde
mutation qualitative dans le sens d’un besoin croissant de diversification
et de personnalisation. Les individus supportent de moins en moins
de suivre des cursus uniformes ou rigides qui ne correspondent pas
à leurs besoins réels et à la spécificité
de leur trajets de vie. Une réponse à la croissance de la
demande par une massification de l'offre (plus de la même chose,
en visant des économies d'échelle) serait une réponse
"industrialiste" à l'ancienne, inadaptée à la flexibilité
et à la diversité désormais requise.
On voit comment le nouveau paradigme de la navigation
(opposé à celui du « cursus ») qui se développe
dans les pratiques de prélèvement d’information et d’apprentissage
coopératif au sein du cyberespace montre la voie d’un accès
à la fois massif et personnalisé à la connaissance.
Les Universités et, de plus en plus, les
écoles primaires et secondaires offrent aux étudiants la
possibilité de naviguer sur l'océan d'information et de connaissance
accessible par Internet. Des programmes éducatifs peuvent être
suivis à distance par le World Wide Web. Les courriers et conférences
électroniques servent au tutoring intelligent et sont mis au service
de dispositifs d’apprentissage coopératif. Les supports hypermédias
(CD-ROM, bases de données multimédia interactives en ligne)
permettent des accès intuitifs rapides et attrayants à de
vastes ensembles d’information. Des systèmes de simulation
permettent aux apprenants de se familiariser pratiquement et à faible
coût avec des objets ou des phénomènes complexes sans
pour autant se soumettre à des situations dangereuses ou difficiles
à contrôler.
Les spécialistes du domaine reconnaissent
que la distinction entre enseignement « en présentiel »
et enseignement « à distance » sera de moins en moins
pertinente puisque l’usage des réseaux de télécommunication
et des supports multimédias interactifs s’intègre progressivement
aux formes plus classiques d’enseignement. L’apprentissage à distance
a longtemps été la « roue de secours » de l’enseignement,
il va bientôt en devenir, sinon la norme, au moins la tête
chercheuse. En effet, les caractéristiques de l’AOD sont semblables
à celles de la société de l'information dans son ensemble
(société de réseau, de vitesse, de personnalisation,
etc.). De plus, ce type d’enseignement est en synergie avec les «
organisations apprenantes » qu’une nouvelle génération
de managers cherche à mettre en place dans les entreprises.
L’apprentissage
coopératif et le nouveau rôle des enseignants
Le point essentiel est ici le changement qualitatif
dans les processus d’apprentissage. On cherche moins à transférer
des cours classiques dans des formats hypermédias interactifs ou
à « abolir la distance » qu’à mettre en œuvre
de nouveaux paradigmes d'acquisition des connaissances et de constitution
des savoirs. La direction la plus prometteuse, qui traduit d’ailleurs la
perspective de l’intelligence collective dans le domaine éducatif,
est celle de l’apprentissage coopératif.
Certains dispositifs informatisés d'apprentissage
de groupe sont spécialement conçus pour le partage de diverses
bases de données et l'usage de conférences et de messageries
électroniques. On parle alors d'apprentissage coopératif
assisté par ordinateur (en anglais : Computer Supported Cooperative
Learning ou CSCL). Dans les nouveaux « campus virtuels », les
professeurs et les étudiants mettent en commun les ressources matérielles
et informationnelles dont ils disposent. Les professeurs apprennent en
même temps que les étudiants et ils mettent à jour
continuellement aussi bien leurs savoirs « disciplinaires »
que leurs compétences pédagogiques. (La formation continue
des enseignants est une des applications la plus évidente des méthodes
de l’apprentissage ouvert et à distance).
Les dernières informations à jour
deviennent facilement et directement accessibles via les bases de
données en ligne et le WWW. Les étudiants peuvent participer
à des conférences électroniques déterritorialisées
où interviennent les meilleurs chercheurs de leur discipline. Dès
lors, la fonction majeure de l’enseignant ne peut plus être une «
diffusion des connaissances » désormais assurée plus
efficacement par d’autres moyens. Sa compétence doit se déplacer
du côté de la provocation à apprendre et à penser.
L’enseignant devient un animateur de l’intelligence collective des
groupes dont il a la charge. Son activité se centrera sur l’accompagnement
et la gestion des apprentissages : incitation à l’échange
des savoirs, la médiation relationnelle et symbolique, le pilotage
personnalisé des parcours d’apprentissage, etc.
Vers
une régulation publique de l’économie de la connaissance
Les réflexions et les pratiques sur l’incidence
des nouvelles technologies dans l’éducation se sont développée
selon des axes divers. De nombreux travaux, par exemple, ont été
menés sur le « multimédia » comme support d’enseignement
ou sur les ordinateurs comme inlassables substituts des professeurs
(enseignement assisté par ordinateur ou EAO). Dans cette vision
- on ne peut plus classique - l’informatique offre des machines à
enseigner. Selon une autre approche, les ordinateurs sont considérés
comme des instruments de communication, de recherche d’information,
de calcul, de production de messages (textes images ou son) à mettre
entre les mains des « apprenants ».
La perspective adoptée ici est encore différente.
L’usage croissant des technologies numériques et des réseaux
de communication interactive accompagne et amplifie une profonde mutation
du rapport au savoir, dont j’ai tenté de brosser les grandes lignes
dans ce chapitre. En prolongeant certaines capacités cognitives
humaines (mémoire, imagination, perception), les technologies intellectuelles
à support numérique redéfinissent leur portée,
leur signification, et parfois même leur nature. Les nouvelles possibilités
de création collective distribuée, d’apprentissage coopératif
et de collaboration en réseau offerte par le cyberespace remettent
en question le fonctionnement des institutions et les modes habituels de
division du travail aussi bien dans les entreprises que dans les écoles.
Comment maintenir les pratiques pédagogiques
en phase avec des processus de transaction de connaissance en voie de transformation
rapide et désormais densément répandus dans la société
? Il ne s’agit pas ici d’utiliser à tout prix les technologies mais
d’accompagner consciemment et délibérément un changement
de civilisation qui remet profondément en cause les formes institutionnelles,
les mentalités et la culture des systèmes éducatifs
traditionnels et notamment les rôles de professeur et d’élève.
Le grand enjeu de la cyberculture, tant sur le
plan de la baisse des coûts que de l’accès de tous à
l’éducation, n’est pas tant le passage du « présentiel
» à la « distance », ni de l’écrit et de
l’oral traditionnels au « multimédia ». C’est la transition
entre une éducation et une formation strictement institutionnalisée
(l’école, l’université) et une situation d’échange
généralisé des savoirs, d’enseignement de la société
par elle-même, de reconnaissance autogérée, mobile
et contextuelle des compétences. Dans ce cadre, le rôle des
pouvoirs publics devrait être...
1) de garantir à chacun une formation élémentaire
de qualité,
2) de permettre à tous un accès ouvert
et gratuit à des médiathèques, à des centres
d’orientation, de documentation et d’autoformation, à des points
d’entrée dans le cyberespace, sans négliger l’indispensable
médiation humaine de l’accès à la connaissance,
3) de réguler et d’animer une nouvelle économie
de la connaissance dans laquelle chaque individu, chaque groupe, chaque
organisation seront considérés comme des ressources d’apprentissage
potentielles au service de parcours de formation continus et personnalisés.
Savoir-flux
et dissolution des séparations
Depuis la fin des années soixante de ce
siècle, les êtres humains ont commencé a expérimenter
une relation avec les connaissances et les savoir-faire inconnue de leurs
ancêtres. En effet, avant cette période, les compétences
acquises au cours de la jeunesse étaient généralement
encore en usage à la fin de la vie active. Ces compétences
étaient même transmises quasiment à l’identique aux
jeunes ou aux apprentis. Certes, de nouveaux procédés, de
nouvelles techniques surgissaient. Mais les innovations se détachant
sur un fond de stabilité, étaient l’exception. A l’échelle
d’une vie humaine, la plus grand partie des savoir-faire utiles étaient
pérennes. Or, de nos jours, la situation a radicalement changé
puisque c’est désormais la majorité des savoirs acquis au
début d’une carrière qui seront obsolètes à
la fin d’un parcours professionnel, voire même avant. Les désordres
de l’économie comme le rythme précipité des évolutions
scientifiques et techniques déterminent une accélération
générale de la temporalité sociale. De ce fait, les
individus et les groupes ne sont plus confrontés à des savoirs
stables, à des classifications de connaissances léguées
et confortées par la tradition mais à un savoir-flux
chaotique, au cours difficilement prévisible dans lequel il s’agit
désormais d’apprendre à naviguer. Le rapport intense
à l’apprentissage, à la transmission et à la production
de connaissances n’est plus réservé à une élite
mais concerne désormais la masse des gens dans leur vie quotidienne
et dans leur travail.
Le vieux schéma selon lequel on apprend
dans sa jeunesse un métier que l'on exerce le reste de sa vie est
donc dépassé. Les individus sont appelés à
changer de profession plusieurs fois dans leur carrière, et la notion
même de métier devient de plus en plus problématique.
Il vaudrait mieux raisonner en termes de compétences variées
dont chacun possède une collection singulière. Les personnes
ont alors à charge d’entretenir et d’enrichir leur collection de
compétences tout au long de leur vie. Cette approche remet en question
la division classique entre période d’apprentissage et période
de travail (puisqu’on apprend tout le temps) ainsi que le métier
comme mode principal d’identification économique et sociale des
personnes.
Par la formation continue, la formation en alternance,
les dispositifs d'apprentissage en entreprise, la participation à
la vie associative, syndicale, etc., il est en train de se constituer un
continuum entre temps de formation, d'une part, et temps d'expérience
professionnelle et sociale, d'autre part. Au sein de ce continuum,
toutes les modalités d'acquisition de compétences (y compris
l'autodidaxie) viennent prendre place.
Pour une proportion croissante de la population,
le travail n’est plus l’exécution répétitive d’une
tâche prescrite mais une activité complexe où la résolution
inventive de problèmes, la coordination au sein d’équipes
et la gestion de relations humaines tiennent des places non négligeables.
La transaction d’informations et de connaissances (production de savoirs,
apprentissage, transmission) fait partie intégrante de l’activité
professionnelle. Utilisant des hypermédias, des systèmes
de simulation et des réseaux d’apprentissage coopératifs
de plus en plus souvent intégrés aux postes de travail,
la formation professionnelle dans les entreprises tend à s’intégrer
à la production.
L’ancien rapport à la compétence
était substantiel et territorial. Les individus étaient reconnus
par leurs diplômes, eux-mêmes rattachés à des
disciplines. Les employés étaient identifiés par des
postes, qui déclinaient des métiers, qui remplissaient des
fonctions. A l’avenir, il s’agira beaucoup plus de gérer des processus
:trajets et coopérations. Les compétences diverses
acquises par les personnes selon leurs parcours singuliers viendront alimenter
des mémoires collectives. Accessibles en ligne, ces mémoires
dynamiques à support numérique serviront en retour les besoins
concrets, ici et maintenant, d’individus et de groupes en situation de
travail ou d’apprentissage (c’est tout un). Ainsi, à la virtualisation
des organisations et des entreprises « en réseau » correspondra
bientôt une virtualisation du rapport à la connaissance.
La
reconnaissance des acquis
C’est évidemment à ce nouvel univers
du travail que l’éducation doit préparer. Mais, symétriquement,
il faut aussi admettre le caractère éducatif ou formateur
de nombre d’activités économiques et sociales, ce qui pose
évidemment le problème de leur reconnaissance ou de leur
validation officielle, le système des diplômes apparaissant
de moins en moins adéquat. Par ailleurs, le temps nécessaire
à homologuer de nouveaux diplômes et à constituer les
cursus qui y mènent n’est plus en phase avec le rythme d'évolution
des connaissances.
Il peut paraître banal d'affirmer que tous
les types d'apprentissage et de formation doivent pouvoir donner lieu à
une qualification ou à une validation socialement reconnue. Pourtant,
nous sommes actuellement très loin du compte. Un grand nombre de
processus d'apprentissage ayant cours dans des dispositifs formels de formation
continue, pour ne pas parler des compétences acquises au cours des
expériences sociales et professionnelles des individus, ne donne
aujourd'hui lieu à aucune qualification. Le rapport au savoir émergent,
dont j’ai esquissé les grands traits, remet en question l’association
étroite entre deux fonctions des systèmes éducatifs
: l’enseignement et la reconnaissance des savoirs.
Les individus apprenant de plus en plus en dehors
des filières académiques, il revient aux systèmes
d’éducation de mettre en place des procédures de reconnaissance
des savoirs et savoir-faire acquis dans la vie sociale et professionnelle.
A cet effet, des services publics exploitant à grande échelle
les technologies du multimédia (tests automatisés, examens
sur simulateurs) et du réseau interactif (possibilité de
passer des tests ou de faire reconnaître ses acquis avec l’aide d’orientateurs,
de tuteurs et d’examinateurs en ligne) pourraient décharger les
enseignants et les institutions éducatives classiques d’une tâche
de contrôle et de validation moins « noble » - mais tout
aussi nécessaire - que l’accompagnement des apprentissages. Grâce
à ce grand service décentralisé et ouvert de reconnaissance
et de validation des savoirs, tous les processus, tous les dispositifs
d'apprentissage, même les moins formels, pourraient être sanctionnés
par une qualification des individus.
L'évolution du système de formation
ne peut être dissociée de celle du système de reconnaissance
des savoirs qui l'accompagne et le pilote. A titre d’exemple, on sait bien
que ce sont les examens qui structurent, en aval, les programmes
d'enseignement. Utiliser toutes les technologies nouvelles dans l’éducation
et la formation sans rien changer aux mécanismes de validation des
apprentissages revient à gonfler les muscles de l’institution scolaire
tout en bloquant le développement de ses sens et de son cerveau.
Une dérégulation contrôlée
du système actuel de reconnaissance des savoirs pourrait favoriser
le développement des formations en alternance et de toutes les formations
accordant une large place à l'expérience professionnelle.
En autorisant l'invention de modes de validation originaux, cette dérégulation
encouragerait également les pédagogies par l'exploration
collective, et toutes les formes d'initiatives à mi-chemin entre
l'expérimentation sociale et la formation explicite.
Une telle évolution ne manquerait pas de
produire d'intéressants effets-retour sur certains modes de formation
de type scolaire, souvent bloqués dans des styles de pédagogie
peu aptes à mobiliser l'initiative, uniquement orientés vers
la sanction finale du diplôme.
Dans une perspective encore plus vaste, la dérégulation
contrôlée de la reconnaissance des savoirs évoquée
ici stimulerait une socialisation des fonctions classiques de l’école.
En effet, elle permettrait à toutes les forces disponibles de concourir
à l’accompagnement de trajets d’apprentissages personnalisés,
adaptés aux objectifs et aux besoins divers des individus et des
communautés concernées.
Les performances industrielles et commerciales
des compagnies, des régions, des grandes zones géopolitiques,
sont étroitement corrélées à des politiques
de gestion du savoir. Connaissances, savoir-faire, compétences
sont aujourd'hui la principale source de la richesse des entreprises, des
grandes métropoles, des nations. Or on connaît aujourd'hui
d’importantes difficultés dans la gestion de ces compétences,
tant à l'échelle de petites communautés qu'à
celle des régions. Du côté de la demande, on constate
une inadéquation croissante entre les compétences disponibles
et la demande économique. Du côté de l'offre, un grand
nombre de compétences ne sont ni reconnues ni identifiées,
et notamment parmi ceux qui n'ont pas de diplôme. Ces phénomènes
sont particulièrement sensibles dans les situations de reconversions
industrielles ou de retard de développement de régions entières.
Parallèlement aux diplômes, il faut imaginer des modes
de reconnaissance des savoirs qui puissent se prêter à une
mise en visibilité sur réseau de l’offre de compétence
et à un pilotage dynamique rétroactif de l’offre par la demande.
La communication par le cyberespace peut être à cet effet
d’un grand secours.
Une fois admis le principe suivant lequel toute
acquisition de compétence doit pouvoir donner lieu à une
reconnaissance sociale explicite, les problèmes de la gestion des
compétences, tant dans l'entreprise qu'à l'échelle
des collectivités locales sont, sinon en voie d'être résolus,
au moins atténués.
|